3.1.2. Phase de Liaison
C'est la partie de la roche qui assure la cohésion des grains. On distingue une matrice ou un ciment.
La matrice
C'est un dépôt. Elle s'est sédimentée en même temps que les éléments qu'elle enrobe, elle est dite primaire ou synsédimentaire. Elle est constituée d'éléments plus fins que ceux qu'elle réunit. Ainsi, des galets et graviers (classe des rudites) peuvent être enrobés dans une matrice sableuse (arénite) ou boueuse (lutite), on obtiendra après consolidation un conglomérat à matrice gréseuse ou à matrice argileuse selon les cas [Planche_11]. Un sable (ou un grès) ne pourra avoir qu'une matrice boueuse (ou argileuse).
Très souvent la matrice est, à l'origine, une boue de la classe des lutites. Cette boue déposée en même temps que les éléments figurés peut être argileuse, terrigène, ou bien carbonatée, allochimique ou orthochimique (micrite), le mélange des deux donne une marne.
- La boue carbonatée ou micritique sera étudiée plus en détail avec les roches carbonatées.
- La boue argileuse est constituée d'un mélange de minéraux argileux détritiques pouvant contenir d'autres minéraux détritiques très fins (silts) et notamment du quartz. Cette boue argileuse provient de la floculation et décantation des suspensions colloïdales. Les minéraux argileux sont cryptocristallins, c'est-à-dire non visibles au microscope. Ils forment un « fond » grisâtre homogène, plus ou moins sombre selon la teneur en matière organique ou bien de teinte jaune à brun foncé selon la teneur en oxyde de fer.
Certains cristaux argileux, bien cristallisés, peuvent être distingués au microscope, au fort grossissement. Cependant, cette détermination demeure difficile et incertaine.
La difficulté majeure dans l'étude des microfaciès contenant des argiles est de déterminer l'origine de celle-ci. Comme cela a été dit précédemment, il est très difficile de déterminer avec certitude si une argile est détritique, ou bien si elle est diagénétique, soit par néogenèse, soit par altération des minéraux en place dans le sédiment ou la roche.
Origine des minéraux argileux
Les minéraux argileux présents dans la phase de liaison des roches sédimentaires peuvent avoir deux origines : (1) une origine primaire résultant du dépôt synsédimentaire d’une boue argileuse détritique dans les interstices du sédiment ; (2) une origine secondaire par des processus de diagenèse tels que l’authigenèse ou la transformation (néogenèse). La distinction entre ces deux origines demeure très délicate, et donc le caractère de matrice (primaire) ou de ciment (secondaire) est difficile à définir. En cas de doute nous conseillons d’utiliser le terme plus général de « phase de liaison argileuse ».
L'authigenèse
L'authigenèse est l'apparition d'un nouveau minéral, en l'occurrence une argile (le plus fréquemment illite ou kaolinite), par réorganisation des hydroxydes d'Al et de Si pour former la charpente d'un phyllo silicate.
La transformation
La transformation d'un minéral en un autre est appelée néogenèse. C'est une transformation lente et progressive, en l'ocurence d'un alumino silicate : feldspath ou mica.
-
Voyons ce qui se passe d'abord avec le feldspath [Planche_12] :
a - Altération modérée, dans un premier temps, en général sous climat tempéré à froid, conduisant à la formation de minéraux argileux de type illite (ou smectite si le drainage est mauvais). La réaction libère de la silice et des cations solubles. Il en résulte une diminution du rapport sialitique Si/Al (qui passe, par exemple pour l'orthose, de 3 à 2), ce qui correspond à une augmentation de la proportion d'aluminium. L'illite est un minéral très voisin des micas dont il possède la même structure, c'est également le minéral argileux le plus commun dans les roches sédimentaires.
b - Pour une altération plus poussée, en général sous climat tropical (chaud et humide), on a la formation de kaolinite, avec libération plus importante que précédemment de silice. Cette silice est éliminée par lessivage sous forme d'hydrolysat Si(OH)4. Le rapport sialitique diminue pour passer de Si/Al=1 à ?. D'où une augmentation encore plus importante de l'aluminium. Ce processus est appelé la kaolinisation.
g - Le stade ultime de l'altération se produit sous des climats tropicaux très lessivants. Ce lessivage très intense élimine toute la silice, il ne subsiste qu'un hydroxyde d'aluminium, la gibbsite, (Al(OH)3) avec un rapport Si/Al=0, qui correspond à la partie essentielle de la bauxite, minerai d'aluminium. Ce processus d'enrichissement extrême en aluminium au détriment de la silice s'appelle l'allitisation. Très souvent, à ce processus s'associe du fer, généralement libéré par les ferromagnésiens, on parle alors de ferrallitisation, phénomène qui intervient dans la formation des latérites qui est étudiée avec les roches résiduelles.
Parmi les feldspaths, on constate que l'altérabilité varie selon leur composition : l'orthose (potassique) est bien moins altérable que les plagioclases (calcosodiques), ce qui explique leur fréquence plus élevée dans les roches sédimentaires. L'altération se marque par des traces à la surface du minéral qui apparaît carié ou corrodé. Il en résulte un aspect piqueté, ou trouble, ce qui est un caractère de reconnaissance majeur sur lame mince [Planche_01, Planche_03].
-
Parmi les micas :
La muscovite (mica blanc), non ferromagnésien, ne s'altère pas, sinon très difficilement. C'est une altération chimique très lente et très progressive qui correspond à une perte d'ion K+. Or nous avons vu dans la partie traitant des roches sédimentaires, que l'extraction par hydrolyse du cation K (cation antistocke) est très difficile, ce qui explique la stabilité de la muscovite. On obtient de l'illite qui, éventuellement selon les processus et les conditions évoqués ci-dessus, peut donner de la kaolinite ou de la smectite . L’altération se marque par une exfoliation des feuillets de mica. Cette déformation est surtout provoquée par la pénétration entre les plans de clivage de molécules d’eau puis des produits d’altération tels que vermiculite, illite et éventuellement kaolinite*.
* Cette disposition est confirmée par des études au microscope électronique, notamment par les travaux de MORAD, 1990)
Ceci provoque l'écartement des plans de clivage. Ces déformations peuvent être observées au microscope, elles se marquent par un renforcement des clivages donnant un aspect « strié » au minéral. L'altération et les déformations débutent aux extrémités des minéraux qui apparaissent d'abord denticulés puis avec un aspect fibreux en éventail ou en « flammèche » ou en « muscle » [Planche_13, Planche_14]. On note aussi parfois une forme ondulée de certains micas [Planche_15], ceci est dû à la flexibilité des micas qui se déforment sous la pression de la compaction ou même des forces tectoniques.
La biotite est beaucoup plus altérable que la muscovite, ce qui explique sa rareté dans les sédiments et les roches relativement anciennes. Le niveau d'altération peut s'exprimer, ici aussi, par la quantité d'ions K+ libérés. La biotite peu oxydée (dominante ferreuse Fe++) est très altérable, elle se comporte comme les ferromagnésiens type amphibole ou pyroxène. La biotite plus oxydée (où domine Fe+++) est plus stable.
L'altération conduit à la formation d'argile (illite, kaolinite le plus fréquemment) qui apparaît entre les plans de clivage dont elle provoque l'écartement, et à la périphérie du minéral. Cette altération s'accompagne de libération d'oxyde ferrique, très peu soluble, et qui précipite immédiatement entre les plans de clivage ou dans les espaces libres à proximité pour constituer un ciment.
Fréquemment la biotite se transforme en chlorite par épigenèse. Cette chlorite apparaît sous forme de taches verdâtres sur le fond brun de la biotite d'origine. La chloritisation gagne de proche en proche l'ensemble du minéral. La chlorite peut également apparaître par néogenèse, soit entre les plans de clivage (phénomène visible au microscope électronique, MORAD, 1990), soit dans les espaces libres ou pores [Planche_16].
Le ciment
C'est une précipitation secondaire qui résulte d'un processus de diagenèse apparu après le dépôt. Cette précipitation s'effectue dans les espaces libres ou pores (espaces intergranulaires, vacuoles, fractures, etc...) à partir de solutions aqueuses sursaturées en certains ions, solutions qui circulent par percolation dans le sédiment ou la roche. Les ions en solution peuvent avoir une origine détritique (altération de la roche mère sur le continent) ou bien de la dégradation par altération de certains minéraux situ, comme nous venons de voir. Le ciment qui soude les éléments figurés entre eux, peut être de nature très variée :
- carbonaté : par précipitation directe de carbonates dans les vides, il sera étudié avec les roches carbonatées [Planche_17],
- ferrugineux : par précipitation directe d'oxyde de fer dans les espaces, cet oxyde provient très souvent de l'altération de minéraux présents sur place dans le sédiment ou la roche [Planche_18],
- argileux : il s'agit ici de minéraux argileux de néogenèse ou de transformation selon les procédés évoqués plus haut ; la difficulté consiste à ne pas les confondre avec une matrice d'argile détritique,
- ciment de sulfate ou de phosphate : relativement rares, ils seront étudiés avec les roches correspondantes,
-
la silice : (essentiellement le quartz) constitue les ciments les plus fréquents dans les roches détritiques terrigènes. On distingue deux types de cimentation siliceuse (voir LUCAS et al., 1976):
les cimentations simples et les cimentations complexes.
Les cimentations simples
Deux processus peuvent être évoqués :
-
La précipitation minérale directe
Elle se produit dans les espaces libres, elle est relativement rare pour la silice. Le quartz qui précipite sous cette forme est le plus souvent la variété calcédoine [Planche_19], qui peut former une mosaïque de petits cristaux plus ou moins globuleux, présentant, par endroit une disposition fibroradiée formant des sphérolithes caractéristiques de la calcédoine. La taille des cristaux qui constituent les mosaïques dépend de leur vitesse de croissance : vitesse lente = gros cristaux, vitesse rapide = petits cristaux.
-
La précipitation minérale par nucléation et nourrissage
C’est le procédé le plus fréquent pour la cimentation siliceuse ou quartzitique. Il s’agit d’addition syntaxique** de quartz à des grains détritiques de même nature qui constituent le support ou le « germe » d’une précipitation directe à partir d’une solution de fluide interstitiel sursaturé. Cet accroissement syntaxique se fait en continuité optique (extinction synchrone) avec le grain de quartz d’origine. Il se présente sous forme d’une frange de croissance limpide à la périphérie du grain primaire. Cette frange de croissance est difficilement discernable si le grain primaire est lui-même limpide. Par contre, si ce grain présente des inclusions ou bien un fin liseré d’impureté (patine) soulignant son pourtour, on peut alors distinguer la silhouette du grain primaire, son "fantôme"[Planche_20, Planche_21].
** Syntaxique : ce dit de la cristallisation d’un minéral de néogenèse, s’orientant sur les cristaux de même nature existant déjà dans la roche (éléments figurés primaires). Exemple : nourrissage quartzitique des grains de quartz, auréole de néogenèse calcitique autour des éléments d’Échinodermes. Les chercheurs d’ ELF Aquitaine (1978) considèrent le terme de syntaxique comme synonyme d’épitaxique.
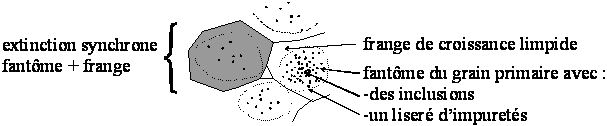 Croissance syntaxique
Croissance syntaxique
La cimentation de la roche, et donc sa consolidation, est proportionnelle à la quantité précipitée.
Les cimentations complexes
On distingue deux phénomènes dans ce type de cimentation :
-
Le phénomène de dissolution inter-granulaire
Ce processus correspond à des interactions chimiques différentielles liées à la diagenèse de compaction de type stylolithe ou plutôt ici « micro stylolithe ». C'est un phénomène très complexe dit de pression-dissolution se traduisant par des inter-pénétrations des surfaces de grains souvent soulignées par des résidus de dissolution [Planche_22].
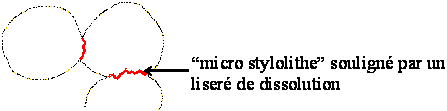 Cimentation complexe : phénomène de dissolution inter-granulaire
Cimentation complexe : phénomène de dissolution inter-granulaire
-
Le phénomène de réaction inter-granulaire
Les réactions entre minéraux peuvent conduire au remplacement d'un minéral par un autre (épigenèse), soit au développement d'un troisième minéral le long de la limite commune [Planche_23]. Les phénomènes liés à l'enfouissement des matériaux déjà lithifiés sont conditionnés par l'état de pression et température des eaux interstitielles. Ils donnent lieu à la définition de « faciès diagénétique » à l'image des « faciès métamorphiques ».
|