4.1.1.2.1.1.7. ProtistesQuatre groupes de Protistes sont très importants en pétrographie sédimentaire parce que leurs représentants ont pu être, à certaines époques et dans certains environnements, très abondants et participer ainsi à la pétrogenèse de certaines roches (craie, calcaires à Nummulites, radiolarites etc…).
Ce sont :
- Les Coccolithophoridés de la famille des Chrysophycées à flagelles ;
- Les Diatomées de la famille des Chrysophycées sans flagelles ;
- Les Foraminifères de la famille des Rhizopodes ;
- Les Radiolaires de la famille des Actinopodes.
Les Diatomées et les Radiolaires possèdent un squelette en silice et seront étudiés plus tard avec les roches siliceuses biogènes. Nous décrirons ici que les Protistes à squelette calcaire.
Les Coccolithophoridés
Ce sont des algues unicellulaires flagellées [Planche_63] sécrétant un squelette externe appelé coque ou coccosphére. La coccosphére est constituée d’éléments calcaires extrêmement petits (3 à 10 µm) appelés coccolithes. Les coccolithes peuvent être très abondants dans la roche, pouvant constituer jusqu’à 90% de la craie ou de certains calcaires lithographiques. Leur taille extrêmement petite ne permet de les observer que très rarement en lame mince sous microscope optique. Leur étude détaillée et leur reconnaissance ne peuvent être faite que sur ultra microscope ou en microscopie électronique, ce qui sort du cadre de notre étude.
Les Foraminifères
Ce sont des organismes unicellulaires dont l’ectoplasme sécrète un test calcaire.
La détermination des Foraminifères constitue une partie essentielle de la reconnaissance des micro faciès. Les Foraminifères présentent un intérêt stratigraphique et paléo écologique primordial. Nous ne donnerons ici que les caractères généraux de reconnaissance de ces organismes au niveau des principales familles. Pour plus de précision on devra se reporter aux cours et ouvrages spécialisés et en particulier le fascicule de TD/TP de STE513 de F. Eynaud, dont une grande partie des illustrations qui vont suivre a été empruntée
Structure
Les Foraminifères benthiques
Il existe une très grande diversité de tests. On distingue :
-
a) Les tests chitinoïdes : très rarement conservés à l’état de fossile.
-
b) Les tests agglutinés : [Planche_64, Planche_65]
Le test est constitué par divers éléments empruntés au milieu ambiant (quartz, bioclastes variés etc.) agglutinés par une sécrétion de chitine, ou de silice, ou de calcaire. Le test a un aspect granuleux dû à l’agglomérat de grains hétérogènes.
Parmi les genres les plus importants on rencontre le plus souvent :
- Orbitoline à test conique, la disposition des loges est trochospiralée, c’est un très bon indicateur de milieu [Planche_66].
- Lituolidés [Planche_67, Planche_67b]
- Choffatella
-
c) Les tests calcitiques micro granuleux, pseudo fibreux :
Ces tests sont constitués par une juxtaposition de grains calcitiques très petits (~ 5µm) (rappelons que l’épaisseur d’une lame mince est d’environ 30 µm) qui donne un aspect granuleux. Parfois les « micro grains » peuvent s’associer pour constituer des pseudo fibres. On peut distinguer selon les espèces :
- des tests constitués d’une couche granuleuse ou bien d’une couche pseudo fibreuse ;
- des tests comprenant les deux types de structures coexistant en deux couches distinctes, il arrive parfois que l’on observe une troisième couche agglutinée.
La famille la plus importante est celle des Fusulinidés [Planche_68, Planche_69, Planche_70, Planche_70b].
-
d) Les tests calcitiques porcelané (imperforés)
A l’observation directe sur la roche en macro échantillon ou sur la lame mince (voir fiches TP n° 114 et 115), le test apparaît blanc, opaque avec un aspect de porcelaine (d’où le nom). Sous microscope, en LPA et LPNA, les tests apparaissent gris, plus ou moins sombre.
Les familles les plus importantes sont :
-
e) Les tests calcitiques hyalins (perforés) : [Planche_78]
Les tests sont clairs et transparents au microscope. Deux types de structure peuvent être observées :
- structure hyaline granuleuse, constituée de la juxtaposition de minuscules grains de calcite (5 à 10 µm) qui donnent, en LPA, une multitude de petits points colorés ;
- structure fibro radiée, constituée de prismes de calcite « aciculaire » (en aiguille) dont l’axe est perpendiculaire à la surface des tests. En LPA, ces cristaux orientés vont donner un phénomène de « pseudo croix noire » caractéristique appelé « texture sphérolitique ».
Les familles les plus importantes sont :
- les Lagénidés [Planche_79, Planche_79b]
- les Rotalidés [Planche_80, Planche_86b]
- les Nummulitidés [Planche_81, Planche_82, Planche_83, Planche_84, Planche_85, Planche_86, Planche_86b, Planche_88]
- les Orbitoïdidés [Planche_87, Planche_88, Planche_89]
Les Orbitoïdidés sont les plus complexes et les plus évolués de toutes les familles en terme de structure.
Ils présentent un intérêt majeur en stratigraphie pour le Crétacé supérieur et le Nummulitique, ils sont abondants à l’Éocène et à l’Oligocène et disparaissent à la fin du Miocène. Le test est généralement lenticulaire biconvexe, certains genres présentent une forme étoilée (G. Asterodiscus), la taille est variable (1mm à 4cm), la surface jamais lisse présente des granules qui correspondent à l’emplacement des piliers internes.
Cette structure atteint une complexité extrême, présentant une couche de loges équatoriales avec un empilement de loges latérales.
Famille des HETEROHELICIDAE ===> Genre Hétérohélix [Planche_90, Planche_95]
Famille des GLOBOTRUNCANIDAE Genre Globotruncana [Planche_91, Planche_95]
------------------------------------LIMITE KT -------------------------------------------------------
Famille des GLOBIGERINIDAE ====> Genre Orbulina [Planche_93]
Genre Globigerina [Planche_92, Planche_96, Planche_97]
Genre Globigerinoïdes [Planche_92]
Famille des GLOBOROTALIDAE ============> Genre Globorotalia [Planche_94]
Remarque sur la nature du test des Foraminifères
Les tests de Foraminifères sont, dans la très large majorité, en calcite. Exceptionnellement, il peut arriver, chez certains agglutinés que le test soit aragonitique. De même, certains Foraminifères hyalins fibro radiés peuvent également être aragonitiques. Dans certains cas, très exceptionnels, certains tests pourraient, à l’origine, avoir été en silice.
Les difficultés de reconnaissance
Comme cela a déjà été signalé pour d’autres organismes fossiles, la diagenèse entraîne des problèmes de reconnaissance. En effet, la recristallisation du test et/ou la précipitation secondaire de sparite dans les loges, ont tendance à donner des plages de mosaïque de calcite relativement homogènes, plus ou moins limpides où toutes structures et organisations originelles ont disparu, dans les cas les plus favorables il peut subsister un « fantôme » de la structure d’origine.
Par ailleurs, à l’état de débris, les restes de certains Foraminifères peuvent être confondus avec d’autres éléments bioclastiques. Par exemple :
– des débris d’agglutinants avec des agrégats notamment de quartz (voir plus loin intraclastes) ;
– d’autres débris (type Orbitoline) peuvent être confondus avec des débris d’Algues à structure cellulaire, ou avec de petits Bryozoaires.
Intérêts
L’intérêt de l’étude des Foraminifères est double :
- stratigraphique (non abordé ici, se référer au cours)
- écologique.
Nous aborderons l’intérêt écologique de l’étude des Foraminifères de façon succincte. Nous conseillons, pour plus d’information de se reporter à de nombreux ouvrages spécialisés et notamment « L’étude microscopique des roches meubles et consolidées de Lucas et al. (1976), tome 2, pages 78 à 81), la brochure sur l’École d’été sur les carbonates récifaux et de plate-forme (Préat et al., 2004) et le tome 2 de l’Essai de caractérisation sédimentologique des dépôts carbonatés de Elf Aquitaine, 1977.
La répartition des Foraminifères en différents biotopes dépend avant tout des conditions physico chimiques du milieu, à savoir : la température, la salinité, la profondeur, l’agitation ou l’hydrodynamisme.
Il peut y avoir interdépendance de deux ou même de plusieurs de ces facteurs. Par exemple, la température et l’hydrodynamisme dépendent de la profondeur.
La profondeur joue également sur la teneur en nutriments (nourriture) et sur la pénétration de la lumière.
L’agitation joue sur l’oxygénation de l’eau.
La majorité des espèces de micro-organismes ont un mode de vie benthique, principalement circa littoral. Les formes planctoniques sont représentées par peu d’espèces mais peuvent être d’une très grande densité d’individus. L’importance de tous ces facteurs va être étroitement liée à la morphologie du milieu.
Si on considère le schéma général des environnements sédimentaires sur une plate-forme carbonatée, on se place, la plupart du temps, dans un cadre géomorphologique comprenant :
- une barrière délimitant ;
- un domaine externe océanique ouvert ;
- un bassin interne plus ou moins isolé
Les variations dans ce schéma résident dans :
- la position de la barrière sur la plate-forme, position qui peut être : externe, en bordure du plateau, médiane, interne ou littorale ;
- dans la nature de la barrière qui peut être : récifale, sédimentaire (levée, cordon, banc etc.), rocheuse (seuil ou barre)
- son amplitude (hauteur), ceci est un point primordial, parce qu’il va conditionner les environnements du domaine interne par son rôle de filtre. En effet, (1) une barrière infra littorale, sous le niveau de la mer aura un rôle restreint, elle amortira les effets de la houle, (2) une barrière au ras du niveau de la mer isolera un bassin interne de l’agitation externe, les eaux y seront calmes à temporairement agitées, les autres caractères physico chimiques seront proche de ceux du domaine externe, (3) une barrière supra tidale, émergée en permanence, pourra avoir un rôle très important dans l’isolation du domaine interne, celle-ci dépendra, avant tout, de l’importance des communications avec l’extérieur au niveau des passes ou embouchure et de l’importance des courants de marée.
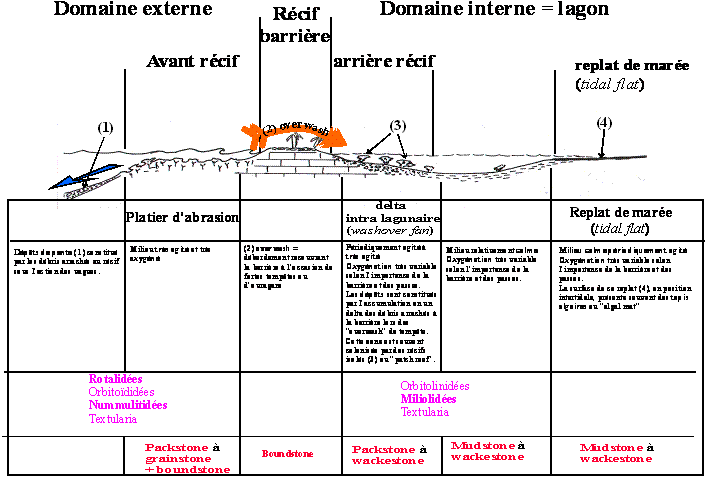
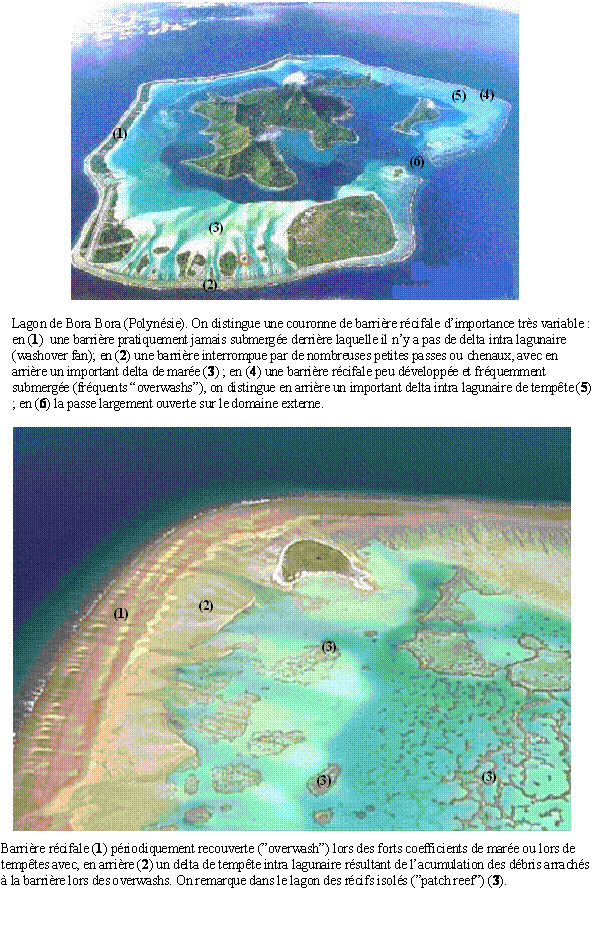
|
FORAMINIFERES |
ENVIRONNEMENTS |
|
| Lituolidés |
Plate-forme ouverte
Peu de variations T° et S‰
Dynamique : peu agité |
[Planche_67, Planche_67b] |
| Orbitolinidés |
Bassin interne protégé
T° et S‰ variables |
[Planche_65, Planche_66] |
| Miliolidés |
Milieu peu profond, interne
Énergie faible à modérée
Mer chaude |
[Planche_71, Planche_72, Planche_73]
[Planche_74, Planche_74b] |
| Alvéolinidés |
Lagune à salinité variable
Température élevée, tropical |
[Planche_75, Planche_76, Planche_77] |
| Rotalidés |
Milieu très agité, périrécifal
Tropical à tempéré |
[Planche_80 , Planche_86b] |
| Nummulitidés |
Milieu externe, du littoral à la bordure du plateau
Hydrodynamique moyenne
Attention formes facilement déplacées (thanatocénoses) par les courants peuvent se retrouver sur la pente ou à l’intérieur des lagunes |
[Planche_81, Planche_82, Planche_83]
[Planche_84, Planche_85, Planche_86]
[Planche_86b, Planche_88 ] |
| Orbitoïdidés |
Milieu ouvert : toute la plate-forme |
[Planche_87, Planche_89, Planche_88] |
| Planctoniques |
Tout domaine mais très abondant en domaine profond, sauf au-delà de la CDD où ils sont dissouts |
[Planche_90, Planche_91Planche_92]
[Planche_93, Planche_94, Planche_95]
[Planche_96, Planche_97] |
|