4.1.1.2.3.2. CimentC’est une précipitation directe de calcite dans les espaces poreux. Ces cristaux précipités à partir d’une eau claire apparaissent, surtout en LPNA, parfaitement limpide, dépourvu d’impuretés.
Les cristaux précipités en ciment s’organisent selon une certaine architecture. On distingue deux types d’organisation : les cristaux en frange et les cristaux en mosaïque.
Les cristaux en frange
[Planche 55] : Les cristaux prennent naissance sur la paroi de l’espace poreux et se développe vers le centre de l’espace (croissance centripète). La croissance est dite aussi radiale, régulière. La lumière laissée libre au centre peut, dans un deuxième temps, se fermer par un remplissage par précipitation de calcite en mosaïque. Selon la taille et l’allongement des cristaux, on peut distinguer :
α) de la calcite en frange palissadique : où les cristaux, allongés radialement, sont plus larges que précédemment, donnant un aspect de « palissade »
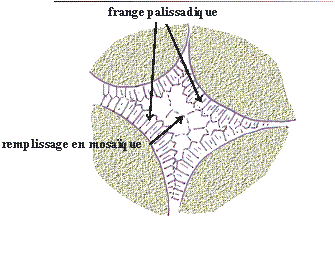
β) de la calcite en frange fibreuse : où les cristaux, en aiguille, sont allongés radialement (perpendiculaire à la paroi*.
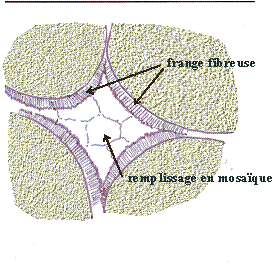
γ) de la calcite en frange granulaire : où les cristaux sont trapus, sans direction d’allongement bien marquée. Ils constituent un alignement de cristaux rhomboédriques ou subrhomboédriques.
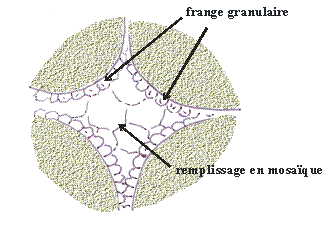
La calcite en mosaïque
[Planche 56] Les cristaux de forme polygonale constituent une mosaïque plus ou moins jointive. On ne distingue pas de direction d’accroissement privilégiée. Selon leur texture on pourra distinguer deux types de calcite en mosaïque :
α) en mosaïque régulière, équigranulaire :**
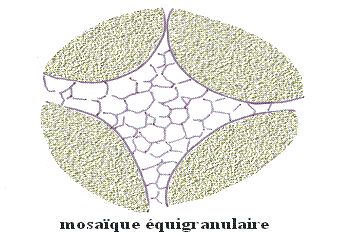
β) en mosaïque irrégulière constituée de cristaux de dimension inégale qui tendent à remplir tout l’espace par accroissement de taille.
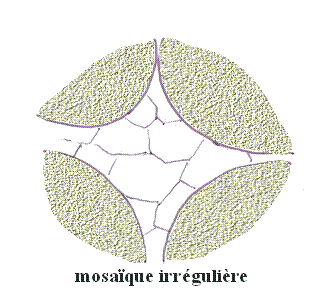
Lorsque les cristaux de calcite atteignent une taille suffisante, deux cas particuliers peuvent se présenter :
γ) La calcite poecilitique : où certains cristaux sont suffisamment importants pour englober un ou plusieurs éléments figurés (bioclastes, pellets, oolithes etc..). On distingue alors une plage cristalline contenant, en inclusion, un ou plusieurs éléments figurés, ne présentant pas de synchronisme d’extinction en LPA. Ces éléments en inclusion dans le cristal sont « étrangers » au réseau cristallin.

δ) La calcite épitaxique : où le cristal de calcite croît à partir d’un élément support (le plus souvent un débris d’Échinoderme), en continuité avec le réseau cristallin de cet élément. Cet accroissement se marque par une frange de croissance limpide autour de l’élément d’origine. Ce dernier et la frange de croissance constituent un seul et même cristal de calcite : en LPA il y a synchronisme d’extinction de l’ensemble***.
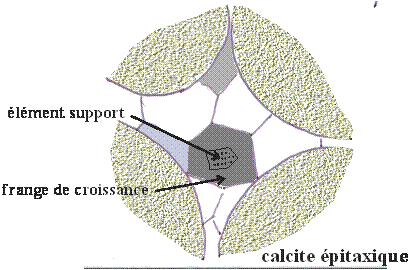
* Ce type de cristallisation est fréquent pour l’aragonite.
** Il arrive que l’on puisse distinguer une organisation peu marquée en frange le long des parois. Il s’agit d’une calcite dite « drusique », provenant, au départ d’une frange de calcite granulaire qui évolue, en cours de croissance, vers une calcite en mosaïque.
*** Le phénomène d’épitaxie ou syntaxie a été décrit à propos de la cimentation des grains de quartz dans les roches détritiques terrigènes.
|