4.1.1.2.1.1.2. AlguesLes débris et encroûtements sont parmi les éléments bioclastiques les plus représentés et les plus significatifs. Les algues [planche_16] peuvent jouer un rôle lithogenétique :
- soit comme « piège à sédiment »
- soit comme agent provoquant la précipitation de CaCO3 dans le milieu
- soit en sécrétant du CaCO3 dans les parois des cellules
Elles se répartissent en trois grandes familles :
- Les Cyanophycées ou algues bleues
- Les Rhodophycées ou algues rouges
- Les Chlorophycées ou algues vertes.
Les Cyanophycées
Les Cyanophycées ont joué un rôle important dans la sédimentation passée et sont à l'origine d'immenses dépôts. Ce sont des algues filamenteuses. Deux groupes s'individualisent selon la nature des filaments :
- groupe à filaments calcaires dont Girvanella est le genre représentatif,
- groupe à filaments non calcaires et visqueux piégeant du matériel sédimentaire ou provoquant la précipitation de carbonates à leur voisinage.
Les Cyanophycées à filaments non calcaire ne sécrètent donc pas directement du carbonate, soit elles « piègent » des particules, en général très fines (particules carbonatées, silts ou boues en suspension), dans le mucilage de leurs filaments ; soit elles provoquent la précipitation de carbonate par changement des condition physico chimique du milieu ambiant.
Les Girvanelles [planche_17] sont des organismes en masses lâches, arrondies en tubes sinueux, très enchevêtrés, rarement ramifiés, parfois cloisonnés transversalement, de 6 à 8 mm de diamètre. Les différentes espèces sont distinguées sur la base du diamètre des tubes et de l'épaisseur de leurs parois.
Les stromatolites et oncolites sont des constructions calcaires d'origine algaire ou présumée telle. Ces algues consistent en filaments visqueux piégeant du matériel en suspension à proximité (silts, débris organiques variés). Il est possible que parfois, ces filaments algaires puissent provoquer la précipitation des carbonates dissous dans le milieu ambiant. Les filaments algaires ne sont pas conservés mais par suite de l’alternance de prolifération de filaments et des éléments piégés on obtient la construction d’une masse calcaire finement stratifiée ou en laminations (alternance de lamines). Rappelons que les stromatolithes sont des formes fixées ou tapissant le fond, les oncolites sont des formes libres en nodule (elles seront étudiées plus loin avec les ooïdes).
La forme des constructions varie avec l'environnement :
- les stromatolites en croûte plus ou moins mamelonnée sur le sol appelées aussi en tapis algaire dans la zone supratidale,
- les stromatolites en forme de monticules isolés ou réunis dans la zone intertidale ou subtidale très peu profonde,
- les oncolites de formes noduleuses libres en zone agitée constamment immergée peu profonde.
a) Minéralogie
Aragonite ou calcite.
b) Forme et micro structure
Les stromatolithes sont des structures sédimentaires et c'est en tant que tels qu'ils seront étudiés plus loin. Les fiches de TP 121 et 122 en donne un bel exemple. Ils se caractérisent par une succession de couches peu épaisses se succédant en nombre parfois assez grand. On a montré leur origine le plus souvent algaire (Cyanophycées). La morphologie de ces couches empilées est extrêmement diverse. Elles peuvent être planes ou mamelonnées (parfois très irrégulières). Les plus gros peuvent provenir de l'intégration d'éléments stromatolithiques plus petits. Ils peuvent se développer en colonnes, associées ou dissociées, ou bien en intumescences en forme de « choux fleur » ou de champignon, elles sont alors fixées sur le fond. Elles peuvent constituer des éléments libres, dont les couches successives (laminés), se disposent concentriquement autour d'un nucléus, elles prennent alors le nom d'oncolithes (fiche TP 110) et [planche_16].
On observe souvent que les couches ou lamines constituent des « doublets » (pouvant se former en 24 heures) alternativement d'origine algaire et d'origine mécanique. Les lamines algaires présentent une épaisseur de 10 à 500 µm et sont formées par le mucilage des Cyanophycées. Les lamines mécaniques ou sédimentaires sont formées par l'agglutination de particules en suspension, de la taille des silts aux sables fins (entre quelques µm et une centaine de µm), sur les filaments mucilagineux de l'algue. Ces lamines peuvent atteindre 1000 µm d'épaisseur.
Remarque : Pour plus d'informations se reporter à l'ouvrage de Lucas et al. (1976).
Les Rhodophycées
[planche_18]
Les parois des cellules sont susceptibles de sécréter des carbonates.
Plusieurs familles :
La plante semble avoir été constituée d'un assemblage de segments dispersés dans le sédiment, après la mort de l'Algue. Dans les formes les plus fréquentes (Permocalculus), les segments sont creux, en forme de manchon ménageant un canal axial et dont les parois sont perforées de pores obliques s'élargissant parfois vers l'extérieur. Les éléments à l'origine en aragonite sont souvent recristallisés en calcite. En coupe tangentielle, ces éléments apparaissent sous forme de plaques percées de pores.
A la mort de l'organisme, le cytoplasme disparaît et il ne subsiste que les parois incrustées de carbonates. Elles se présentent sous forme d'un fin liseré micritique. Le vide laissé par la cellule peut être comblé par une boue micritique ou bien par une précipitation secondaire de ciment sparitique. Les thalles sont, la plupart du temps, structurés en faisceaux de cellules alignées.
Algues encroûtantes en calcite. Le thalle est de forme circulaire ou elliptique et présente un réseau de cellules polygonales allongées radialement, en faisceaux.
3) Les Corallinacées
Elles constituent un groupe très important d'Algues calcaires (calcitiques). Elles sont fréquemment représentées dans les roches carbonatées et jouent un rôle important dans l'interprétation des microfaciès. Elles se subdivisent en deux sous groupes :
-
a) Les Mélobésiées
Elles comprennent la très importante famille des Lithothamnium dont la fiche TP 120 en donne un bon exemple. Ce sont des Algues encroûtantes ou arborescentes, inarticulées. La forme et la disposition des cellules permettent, parfois, de distinguer deux parties :
- l'hypothalle intérieur,
- le périthalle à la périphérie.
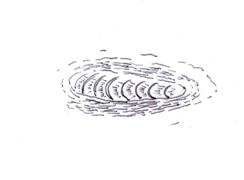 Schéma d'un thalle de Mélobésiées montrant la disposition dite « en nid d'abeille »
Schéma d'un thalle de Mélobésiées montrant la disposition dite « en nid d'abeille »
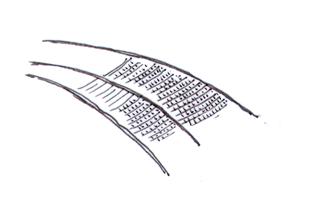 Les vestiges des cellules algaires constituent une fine maille, dite « en nid d'abeille, carrée, rectangulaire, hexagonale etc...
Les vestiges des cellules algaires constituent une fine maille, dite « en nid d'abeille, carrée, rectangulaire, hexagonale etc...
Les Mélobésiées vivent dans des eaux marines, à salinité normale, depuis le niveau de basse mer jusqu'à une trentaine de mètres pour les formes ramifiées et jusqu'à une centaine de mètres pour les formes encroûtantes. Elles prolifèrent dans les zones où l'eau est constamment renouvelée et agitée par les vagues et les courants. Les formes encroûtantes atteignent leur maximum d'épaisseur au niveau du talus récifal. Leur épaisseur diminue avec la profondeur et dans la zone arrière récifale. Les formes branchues massives prolifèrent sur le talus récifal, alors que les formes finement ramifiées se développent dans les eaux très peu profondes des lagons arrière récifaux.
Les Mélobésiées encroûtantes forment une croûte, mince ou épaisse, à la surface lisse ou mamelonnée, parfois couverte d'excroissances. Deux genres sont donnés en exemple : Lithothamnium ou Archéolithothamnium [planche_21] et Ethelia [planche_22].
Pour les Mélobésiées branchues, un genre (Agardhiellopsis) est donné en exemple [planche_23].
Remarque : La diagenèse, précipitation ou recristallisation de la calcite rend, souvent, la détermination de débris de mélobésiées délicate, voir impossible.
-
b) Les Corallinées [planche_24]
Ce sont des Algues calcaires arborescentes et articulées dont on ne trouve, dans les roches, que des fragments désarticulés.
Les Peyssoneliacées : Constituées d'aragonite, ce sont des Algues encroûtantes ou en « coussinets ». Elles montrent souvent une structure en gerbe conservée à l'état de fantôme lors de la transformation aragonite => calcite.
Exemples de microfaciès à Algue Rhodophycées :
[planche_25] Algue Rhodophycée Mélobésiée actuelle encroûtante stratiforme
[planche_26] Algue Rhodophycée encroûtante en nodule>
[planche_27] Algue Rhodophycée actuelle arborescente
[planche_28] micro faciès contenant des débris d'algues Rhodophycées probablement de la famille des Mélobésiées pour la plupart
[planche_29] montre un encroûtement d'Algue Rhodophycées
[planche_30] montre des bioclastes d'origine algaire : débris de Rhodophycées, la forte cristallisation ne permet pas de reconnaître à quelle famille on à affaire
Les Chlorophycées
[planche_31]
Trois ordres présentent un intérêt dans l'analyse pétrographique des roches carbonatées :
- les Caulerpales ou Codiacées
- les Dasycladales
- les Chlorococcales.
1) Les Caulerpales ou Codiacées
Groupe d'Algues vertes dont les parois du thalle sont calcifiées.
Les morphologies sont extrêmement variées :
- en filaments dispersés en tous sens et constituant des coussinets encroûtant,
- en éventail dans un plan,
- arborescents pouvant se décomposer en articles cylindriques ou plans.
Minéralogie : aragonite.
Forme et structure : La calcification des parois se fait par de l'aragonite fibreuse orientée perpendiculairement à la surface. La calcification progresse de l'extérieur du thalle vers l'intérieur.
L'aragonite se transforme, par diagenèse, en calcite. Les structures peuvent être conservées ou non. Remarquons également que les vides ou vacuoles de la structure d'origine peuvent être comblés par de la sparite de précipitation. Les formes articulées (telles que Haliméda) se désarticulent après leur mort et libèrent des éléments qui peuvent être très abondants et constituer, à eux seuls, des sables ou des calcaires dits « à Haliméda ».
Il existe un très grand nombre de genres et d'espèces de Caulerpales. Les genres pris en exemple sur les planches suivantes illustrent bien cette diversité :
Haliméda : [planche_32] [planche33]
Cayeuxia : [planche_34]
Bacinella : [planche_35]
Lithcodium : [planche_36]
Marinella : [planche_37]
Pycnoporidium : [planche_38]
2) Les Dasycladales
Ce sont des Algues constituées d'une tige centrale à partir de laquelle se développent des branches primaires. Dans la plupart des genres, ces branches sont arrangées autour de la tige comme les rayons d'une roue (verticille). Généralement, ces branches primaires donnent naissance à des touffes de branches secondaires qui, à leur tour, peuvent donner naissance àdes branches tertiaires.
Minéralogie : aragonite
Forme et structure : la précipitation d'aragonite dans les parois de l'Algue va constituer des manchons et donne une structure dite siphonnée à manchon calcaire.
Les Dasycladales présentent une complexité morphologique extrême, ce qui rend la détermination spécifique très difficile et aléatoire. Une telle analyse nécessite des séries de lames minces selon différentes sections. En ce qui nous concerne notre analyse se limitera à reconnaître que les débris, observés proviennent d'Algues vertes pouvant éventuellement appartenir à l'ordre des Dasycladales. La structure des Dasycladales est représentée schématiquement ci-dessus.
Les parties végétatives (rameaux, sporanges etc.) incluses dans le manchon font place, après la mort, lorsque la matière organique a disparu, à des vides ou vacuoles internes qui, ajoutés aux pores, vont constituer une porosité interne. Cette porosité pourra rester telle quel, se remplir de boue matricielle (micrite) ou bien d'un ciment de précipitation secondaire (sparite). En lame mince, les Dasycladales sont représentées sous forme de fragments pouvant être usés, ce qui ne facilite pas la reconnaissance. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, les phénomènes diagénétiques de transformation aragonite => calcite peuvent effacer, au moins partiellement, la structure primaire.
Les Dasycladales sont des formes d'eau peu profonde (0 à 30 m), chaude, en arrière des barrières récifales ou sur des plates-formes peu profondes.
Ici aussi le nombre et la variabilité des genres est extrême. Pour plus d'information il faudra se reporter à des ouvrages spécialisés. Nous donnons quatre exemples de genre de Dasycladacés parmi tant d'autres :
Acicularia : [planche_39]
Cylindroporella : [planche_40]
Macroporella : [planche_41]
Paleodasycladus : [planche_42]
Exemple de micro faciès à Dasycladales [planche_43]
Ce sont des Algues planctoniques d'eau douce. Elles peuvent pulluler et donner, sur le fond, après leur mort, un sapropel qui pourra évoluer en un charbon très riche en produits volatiles (exemple le charbon « bog-head »).
Ces Algues sont représentées souvent sous forme de boules pouvant montrer des cellules superficielles et des tubes rayonnants.
Les Charophytes :
Ce sont des organismes végétaux entre les Algues, les Mousses et les Lichens. Ils vivent actuellement en milieu aquatique d'eau douce, saumâtre ou sursalé. On n'en connaît pas actuellement en milieu marin. Pourtant on a trouvé des restes fossiles de Charophytes associés à des bioclastes marins tels que des Echinodermes. Ont-ils vécu sur place ou bien ont-ils été amenés ?
Les Charophytes sont capables de fixer le carbonate de calcium et de calcifier leur parois cellulaire en particulier de leurs organes reproducteurs : les oogones. Celles-ci représentent la partie la plus fréquemment fossilisée pouvant parfois constituer l'essentiel de la roche (exemple calcaire à Chara, ou bien meulière à Chara). Les restes de Charophytes appelés « chara » sont difficiles à identifier. Ils se présentent sous forme de tige à cellules cylindriques portant des rameaux verticillés. Plus caractéristiques sont les oogones. Elles ont une taille comprise entre 0.5 et 1.5 mm et sont ornées de 5 tubes enroulés en spirale. En lame mince, on observe des « boudin » spiralés faits de calcite fibreuse. [planche_44]
Exemple de micro faciès à Charophytes (calcaire à chara) [planche_45]
|