5.1. Eléments de Minéralogie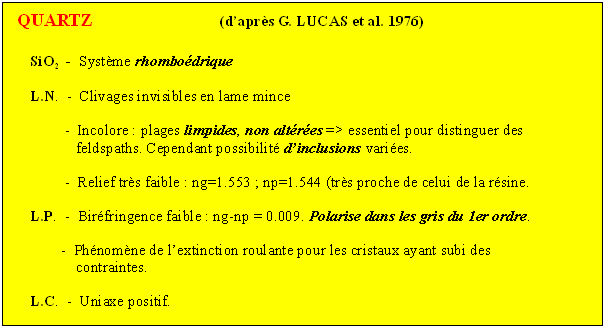
Variétés de quartz fréquentes dans les silicifications secondaires (d’après LUCAS et al., 1976)
La calcédoine : ou silice fibreuse. Variété de quartz à cristallisation plus ou moins incomplète. Les micro cristaux fibreux sont joints entre eux par de la silice désordonnée à cause d’impuretés. Cette hétérogénéité dans la cristallisation produit des phénomènes de diffusion de la lumière donnant une teinte brunâtre au microscope.
L’opale : Silice à cristallisation très imparfaite, très riche en eau et en cations.
Isotrope, à indice très bas (1.43), à fort relief négatif, incolore, parfois jaune chamois (teinte due à la diffusion de la lumière), reflet blanc bleuté en lumière diffusée.
Les spicules d’Eponges, les tests de Radiolaires et de Diatomées sont constitués, à l’origine, par de l’opale à cristallinité quasi nulle.
Les roches siliceuses non détritiques sont constituées en très grande partie de silice formée dans le bassin de sédimentation*. On distingue trois processus de formation :
- biochimique, à partir d’accumulation d’organismes qui utilisent la silice présente dans le milieu pour édifier leur squelette ou leur test ;
- physico chimique par précipitation ou floculation de la silice
- par diagenèse.
Les roches siliceuses « mixtes », contenant une certaine proportion d’éléments détritiques sont appelées gaizes. Les gaizes renferment le plus souvent des spicules d’Eponges et un ciment d’opale qui se transforme avec le temps en calcédoine, puis en quartz. Souvent les gaizes ont une teinte verdâtre due à la présence de glauconie. Plus rarement, les gaizes peuvent contenir des Radiolaires ou des Diatomées, elles sont dites alors gaizes à Radiolaires ou gaizes à Diatomées.
* Ces roches peuvent contenir accessoirement, comme pour les roches carbonatées, une certaine proportion d’éléments détritique terrigènes (quartz).
|